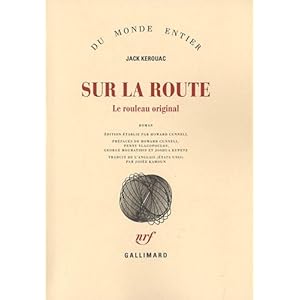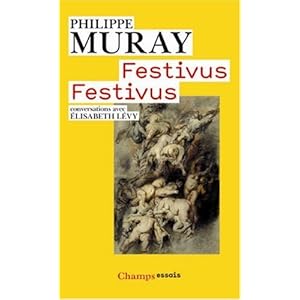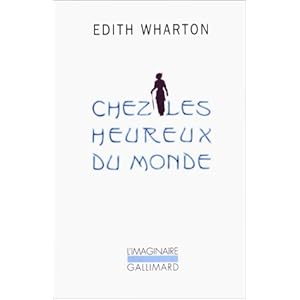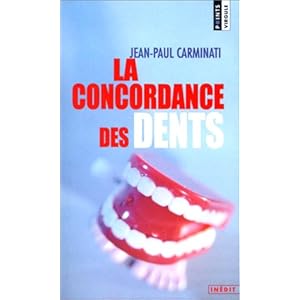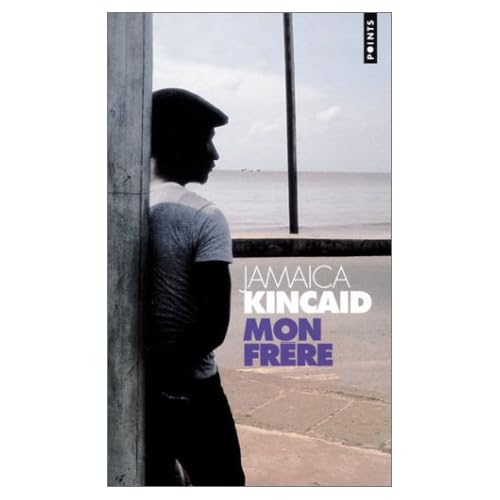Lawrence W. LEVINE, Culture d'en haut, culture d'en bas -- L'émergence des hiérarchies culturelles aux États-Unis, traduit de l'anglais par Marianne Wollven et Olivier Vanhée, préface de Roger CHARTIER, titre original Highbrow/Lowbrow. The Emergence of Cultural Hierarchy In America (1988), Éditions La Découverte, Paris, avril 2010 (336 pages).
Le monde de l'édition a parfois de ces lenteurs qu'on se saurait, comme cela a été fait pour telle symphonie de Schubert, qualifier de divines. Plus de vingt ans pour traduire en français cet important ouvrage : on s'interroge sur l'américanophilie de nos chers cousins. Et quand on la compare à leur anglophilie d'il y a un siècle -- lisez Proust -- on ne s'étonne pas que, j'ose l'anachronisme, l'attrait du
bling-bling l'emporte, en matière d'édition comme de mode sur le goût, c'est là leur côté Odette de Crécy. Il m'arrive de me demander si nous sommes si différents, mais c'est là une toute autre affaire, et baste de la digression.
Céline DION ou Cecilia BARTOLI ou comme on dirait en anglais
lowbrow ou
highbrow ? Zat iz ze kwechtion.Autrement dit d'où nous vient cette notion qu'il y a une hiérarchie culturelle, du populaire et de l'élitisme ? Je donne la parole à l'auter :
« L'une des thèses centrales de cet ouvrage est que, les catégories primaires de la culture étant le produit d'idéologies qui ont sans cesse été sujettes à modifications et transformations, les périmètres de nos divisions culturelles ont été bien plus perméables et variables que fixes et immuables. »
Voici qui semble fort sérieux pour un samedi matin du début de septembre. Résumons : il s'agit d'une étude sur la fragmentation de la culture « américaine » développée sur deux axes : Shakespeare et l'opéra. Avec, au passage, des thèmes qui nous sont très familiers, comme le complexe d'infériorité du Nouveau Monde envers la vieille Europe, et inversement le phénomène de rejet, comme élitiste, des manifestations ou formes culturelles de la seconde. N'a-t-on pas connu dans les années soixante quelque chose de semblable avec les polémiques autour du joual et du
bon français ?
On apprend ainsi que si Shakespeare était toujours considéré au début du XIXe siècle comme un auteur populaire, et joué un peu comme on joue dans nos théâtres de variétés, il est devenu, essentiellement après la guerre de Sécession, d'avantage un auteur pour public cultivé, ou qui se voulait tel, ou qui se représentait comme tel. Cela peut sembler insignifiant, mais le sang a coulé, et pas seulement métaphoriquement : les émeutes de l'
Astor Place, le 10 mai 1849 ont fait vingt-cinq morts et plus d'une centaine de blessés, où les partisans d'un comédien américain ont affronté ceux d'un comédien anglais.
Bref, on constate que la notion de culture évolue, du moins change, avec le temps et les catégories culturelles tendent à se brouiller, et les différents secteurs des arts voulant élargir leur public essaient de se « démocratiser » : surtitres à l'opéra, expositions
blockbusters dans les musées. Doit-on y voir la marchandisation de la culture et sa mutation en ce qu'on appelle désormais les industries culturelles ? Le débat est encore et toujours vif entre les tenants du
highbrow et ceux du
monde ordinaire. L'intérêt du livre de LEVINE est de nous montrer qu'il s'agit là de débats idéologiques et que, contrairement à ce que l'on croit, ou aimerait croire, il n'y a pas, ni, semble-t-il, jamais eu de Haute Culture, ni de Basse Culture, mais que des marques de distinction sociale. Pour simplifier, on irait à l'opéra comme on s'affiche en Porsche : pour se différencier, pour se retrouver entre soi. Et l'on songe aussitôt à Régis DEBRAY, mais il est temps de fermer ce billet déjà assez bavard.
Un clic sur le titre de l'article ouvre la page de l'éditeur.